Nous qui n'étions rien
Madeleine Thien
Pour ma mère, mon père, Katherine et Rawi
ARBRE GÉNÉALOGIQUE
PARTIE I
Je m’interroge : notre vie d’homme compte mille chemins merveilleux, mais combien en empruntons-nous ?
ZHANG WEI,
Le vieux bateau
De toutes les scènes qui couvraient les parois des grottes, les plus riches et les plus complexes décrivaient le paradis.
COLIN THUBRON,
L’ombre de la route de la Soie
1
En un an, mon père nous a quittées deux fois. La première pour mettre fin à son mariage, la seconde en s’enlevant la vie. Cette année-là, en 1989, ma mère est allée à Hong Kong pour enterrer mon père dans un cimetière près de la frontière chinoise. Puis, effondrée, elle s’est empressée de rentrer à Vancouver, où j’étais restée seule. J’avais dix ans.
Voici ce dont je me souviens :
Mon père a un visage beau et sans âge ; c’est un homme bon mais mélancolique. Il porte des lunettes à monture invisible ; ses verres semblent flotter devant lui comme de très fins rideaux. Ses yeux, brun foncé, sont prudents et incertains ; il n’a que trente-neuf ans. Mon père s’appelle Jiang Kai et il est né dans un petit village en bordure de Changsha. Plus tard, quand j’ai su qu’il avait été un pianiste célèbre en Chine, j’ai pensé à la manière dont ses doigts tapotaient la table de cuisine et parcouraient les comptoirs et les doux bras de ma mère jusqu’au bout de ses mains, ce qui la rendait folle de rage, et moi, de joie. C’est lui qui m’a donné mon nom chinois, Jian Li-ling, et mon nom anglais, Marie Jiang. Je n’étais qu’une enfant quand il est mort, et les rares souvenirs que je possédais, si fragmentaires et imprécis fussent-ils, étaient tout ce que j’avais de lui. Je ne m’en suis jamais départie.
Pendant ma vingtaine, au cours des années difficiles qui ont suivi la mort de ma mère, j’ai consacré ma vie à l’observation des nombres, aux conjectures, à la logique et aux preuves, les outils dont nous, mathématiciens, disposons pour interpréter mais aussi décrire le monde. Depuis dix ans, je suis professeure à l’université Simon Fraser, au Canada. Les nombres m’ont permis d’aller et venir entre l’incroyablement grand et le magnifiquement petit, de mener une existence loin de mes parents, de leurs histoires et rêves insatisfaits ainsi que des miens – c’est du moins ce que je croyais alors.
Il y a quelques années, en 2010, je marchais dans le quartier chinois de Vancouver lorsque je suis passée devant une boutique où on vendait des DVD. Je me souviens qu’il tombait des cordes et que les trottoirs étaient déserts. De la musique de concert s’échappait de deux énormes haut-parleurs devant le commerce. Je connaissais la musique, la Sonate pour piano et violon no 4 de Bach. Elle m’a happée avec la même fermeté que si quelqu’un m’avait tirée par la main. Le contrepoint, qui retenait ensemble le compositeur, les musiciens et même le silence, la musique, avec ses vagues tourbillonnantes de douleur et d’extase, tout était exactement comme dans mon souvenir.
Étourdie, je me suis appuyée contre la vitre.
Puis, soudain, j’étais en voiture avec mon père. J’entendais les flaques d’eau gicler contre les pneus et mon père fredonner. Il était tellement vivant, tellement aimé que son incompréhensible suicide m’a dévastée une fois de plus. À ce moment, mon père était mort depuis deux décennies, et jamais un souvenir d’une telle pureté ne m’était venu. J’avais trente et un ans.
Je suis entrée dans la boutique. Le pianiste, Glenn Gould, est apparu sur un écran plat : lui et Yehudi Menuhin interprétaient la sonate de Bach que j’avais reconnue. Vêtu d’un habit sombre, Glenn Gould était penché sur le piano ; les motifs qu’il entendait dépassaient largement les limites de la perception du commun des mortels, et il m’était… si familier, comme une langue, un monde entier que j’aurais oubliés.
En 1989, pour ma mère et moi, la vie était devenue une série de routines nécessaires : le travail et l’école, la télévision, les repas, le sommeil. Le premier départ de mon père était survenu alors que des événements historiques avaient lieu en Chine, événements que ma mère suivait de manière obsessionnelle sur CNN. Je lui demandais qui étaient ces manifestants, et elle répondait que c’étaient des étudiants et des gens ordinaires. Je lui demandais si mon père était là et elle disait : « Non, c’est la place Tian’anmen, à Pékin. » Les manifestations, qui avaient attiré plus d’un million de citoyens chinois dans les rues, avaient commencé en avril, alors que mon père vivait encore avec nous, et elles s’étaient poursuivies après sa disparition à Hong Kong. Puis, le 4 juin et pendant les jours qui ont suivi le massacre, ma mère a pleuré. Je la regardais, soir après soir. Ba avait fui la Chine en 1978 et il n’avait pas le droit d’y retourner. Mais mon incompréhension se rattachait aux choses que je pouvais voir : ces images chaotiques et effrayantes de gens et de tanks, et ma mère devant l’écran.
Cet été-là, comme dans un rêve, j’ai continué mes leçons de calligraphie au centre culturel local. Avec un pinceau et de l’encre, je recopiais de la poésie chinoise, un vers après l’autre. Mais les mots que je savais reconnaître – grand, petit, fille, lune, ciel (大, 小, 女, 月, 天) – étaient rares. Mon père parlait le mandarin et ma mère, le cantonais, mais je ne maîtrisais que l’anglais. Au départ, le casse-tête de la langue chinoise m’était apparu comme un jeu, un plaisir, mais mon incapacité à comprendre avait commencé à me déranger. Encore et encore, je traçais des caractères que je n’arrivais pas à déchiffrer ; je les dessinais de plus en plus gros, jusqu’à ce que l’excédent d’encre traverse le fin papier et le déchire. Je m’en fichais. J’ai cessé d’y aller.
En octobre, deux policiers se sont présentés à notre porte. Ils ont informé ma mère que Ba était mort, et que le bureau du coroner de Hong Kong s’occuperait du dossier. Ils ont dit que sa mort était un suicide. Alors le silence (qù) est devenu une personne à part entière, une personne qui vivait dans notre maison. Il dormait dans le placard avec les chemises, pantalons et chaussures de mon père, et protégeait ses partitions de Beethoven, Prokofiev et Chostakovitch, ses chapeaux, son fauteuil et sa tasse spéciale. Le silence (闃) s’installait dans nos esprits et s’agitait comme un océan à l’intérieur de ma mère et moi. Cet hiver-là, Vancouver était encore plus gris et humide que d’habitude, comme si la pluie était un tricot épais que nous ne pouvions enlever. Je m’endormais convaincue qu’au matin Ba viendrait me réveiller comme il l’avait toujours fait, sa voix me tirant de mon sommeil. Puis cette illusion s’est remplie d’absence, me faisant souffrir plus que tout ce qui était arrivé.
Les semaines ont passé, et 1989 a fondu dans 1990. Ma et moi dînions sur le canapé tous les soirs parce qu’il n’y avait pas de place sur la table. Les documents officiels de mon père – certificats de toutes sortes, déclarations de revenus – avaient déjà été classés, mais le fourbi persistait. Au fur et à mesure que Ma approfondissait sa fouille de l’appartement, d’autres bouts de papier faisaient surface : des partitions, quelques lettres que mon père avait écrites sans les poster (Pinson, je ne sais pas si cette lettre te parviendra, mais…) et encore d’autres carnets. En regardant ces objets s’accumuler, je me disais que ma mère s’attendait à ce que Ba se réincarne en feuille de papier. Ou peut-être qu’elle croyait, comme les anciens, que les mots inscrits sur une page étaient des talismans capables de nous protéger.
Presque chaque soir, Ma s’asseyait parmi eux, toujours dans ses vêtements de bureau.
Je m’efforçais de ne pas la déranger. Je restais dans le salon adjacent et j’entendais, de temps en temps, le bruit presque imperceptible des pages qu’elle tournait.
Le qù de sa respiration.
La pluie qui explosait et fouettait les fenêtres.
Nous étions suspendues dans le temps.
Encore et encore, le bus électrique numéro 29 passait avec un bruit de ferraille.
Je fantasmais des conversations. J’essayais d’imaginer Ba renaissant dans l’autre monde, s’achetant un nouveau journal intime, utilisant une autre devise et glissant la monnaie dans la poche d’un manteau neuf, un léger manteau de plumes, ou peut-être une cape en laine de chameau, un vêtement assez résistant pour le paradis et l’enfer.
Pendant ce temps, ma mère se changeait les idées en essayant de retrouver la trace des membres de la famille de mon père, où qu’ils fussent, pour leur dire que le fils, le frère ou l’oncle qu’ils avaient perdu de vue n’était plus de ce monde. Elle s’est mise à chercher le père adoptif de Ba, un homme qui vivait jadis à Shanghai, connu comme « le Professeur ». Il était le seul parent que Ba ait jamais évoqué. La recherche d’informations était lente et laborieuse : les courriels et Internet n’existaient pas à l’époque. Il était donc facile pour Ma d’envoyer une lettre, mais difficile d’obtenir une vraie réponse. Mon père avait quitté la Chine longtemps auparavant, et si le Professeur avait été encore vivant, il aurait été prodigieusement vieux.
Le Pékin de la télévision, avec ses funérailles et ses familles éplorées, avec ses tanks postés aux intersections, hérissés de fusils, était à des lustres du Pékin que mon père avait connu. Mais je me dis parfois qu’il n’était pas si différent, après tout.
Quelques mois plus tard, en mars 1990, ma mère m’a montré le Livre des traces. Elle était assise à la table ce soir-là, à sa place habituelle, et elle lisait. Dans sa main, le carnet long et étroit avait les proportions d’une porte miniature. Sa reliure en ficelle de coton noisette était lâche.
L’heure de mon coucher était passée depuis longtemps quand soudain Ma m’a remarquée.
– Mais qu’est-ce qui t’arrive ?
Déroutée par sa propre question, elle a ajouté :
– As-tu fini tes devoirs ? Quelle heure est-il ?
J’avais fini depuis longtemps et j’étais en train de regarder un film d’horreur dont j’avais coupé le son. Je m’en souviens encore : un homme venait d’être tué avec un pic à glace.
– Il est minuit, ai-je dit, troublée par la victime qui paraissait aussi molle que de la pâte.
Ma mère m’a tendu la main et je l’ai rejointe. Elle a refermé son bras autour de ma taille et l’a serrée.
– Tu veux voir ce que je lis ?
Je me suis penchée sur le carnet, j’ai scruté l’assemblage de mots. Les signes chinois descendaient sur la page comme des traces d’animal dans la neige.
– C’est une histoire, a dit Ma.
– Oh. Quel genre d’histoire ?
– Je crois que c’est un roman. Il y a un aventurier nommé Da-wei qui s’embarque pour l’Amérique, et une héroïne appelée Quatre-Mai qui traverse le désert de Gobi à pied.
J’ai regardé plus attentivement, mais les mots demeuraient illisibles.
– Il fut un temps où les gens recopiaient des livres entiers à la main, m’a expliqué Ma. Les Russes appelaient ça samizdat, et les Chinois appelaient ça… en fait, je ne crois pas que nous avons un nom pour ça. Regarde comme ce carnet est sale, il y a même des brins d’herbe dessus. Dieu sait combien de gens l’ont trimballé un peu partout… Il a plusieurs dizaines d’années de plus que toi, Li-ling.
Tout est plus vieux que moi, ai-je pensé. Je lui ai demandé si c’était Ba qui l’avait recopié.
Ma mère a secoué la tête en disant que la calligraphie était belle, l’œuvre d’un grand artiste, alors que l’écriture de mon père était passable.
– Ce carnet est un chapitre appartenant à quelque chose de plus long. Ici, ça dit : numéro 17. On ne mentionne pas qui est l’auteur, mais regarde, il y a un titre, là, le Livre des traces.
Elle a reposé le calepin. Sur la table, les papiers de mon père ressemblaient à de l’écume surgissant à la crête d’une vague prête à exploser sur le tapis. Tout notre courrier s’y trouvait aussi. Après le Nouvel An, Ma avait commencé à recevoir des lettres de Pékin, des condoléances de musiciens de l’Orchestre philharmonique central qui venaient d’apprendre la mort de mon père. Ma lisait ces lettres avec un dictionnaire sous la main car elles étaient rédigées en chinois simplifié, qu’elle n’avait jamais appris. Éduquée à Hong Kong, ma mère avait étudié les sinogrammes traditionnels. Mais sur le continent, dans les années cinquante, de nouveaux caractères plus simples étaient devenus la norme de la Chine communiste. Des milliers de mots avaient changé. Par exemple, écrire (xiĕ) était passé de 寫 à 写, et le verbe savoir (shí), de 識 à 识. Même Parti communiste (gòng chăn dăng) était passé de 共 產 黨 à 共 产 党. Parfois, Ma parvenait à discerner l’ancienne forme du mot ; d’autres fois, elle devinait le sens. Elle disait que c’était comme lire une lettre venue du futur, ou parler à quelqu’un qui lui aurait tourné le dos. Tout cela était compliqué par le fait qu’elle ne lisait plus souvent en chinois, et exprimait la plupart de ses pensées en anglais. Elle n’aimait pas que je parle cantonais. Elle me disait : « Ton accent est complètement déformé. »
– Il fait froid, ai-je chuchoté. Mettons nos pyjamas et allons nous coucher.
Ma fixait le carnet, m’écoutant à peine.
– Mère va être fatiguée demain matin, ai-je insisté. Mère va reporter la sonnerie du réveil vingt fois.
Elle a souri mais, derrière ses lunettes, son regard s’est focalisé sur quelque chose.
– Au lit, a-t-elle dit. N’attends pas Mère.
J’ai embrassé sa joue si douce.
– Qu’est-ce qu’un bouddhiste dit à un marchand de sandwichs ? a-t-elle demandé.
– Quoi ?
– Pourriez-vous m’en faire un avec tout ?
J’ai ri, gémi et ri de nouveau, puis frissonné en repensant à la victime à la télé, à sa peau pâteuse. Avec un sourire, elle m’a poussée fermement vers ma chambre.
Dans mon lit, je me suis mise à méditer sur certains faits.
D’abord, au sein de ma classe de cinquième, j’étais une personne complètement différente. J’étais tellement aimable et épanouie, tellement performante que je me demandais si mon cerveau et mon âme n’étaient pas en train de se dissocier.
Deuxièmement, dans les pays pauvres, les gens comme Ma et moi étaient moins seuls. À la télévision, les pays pauvres apparaissaient comme des endroits bondés, des ascenseurs surchargés qui tentaient de s’élever vers le ciel. Les gens dormaient à six dans un lit, douze dans la même chambre. Là, on pouvait toujours énoncer ses pensées à voix haute, certain que quelqu’un entendrait, volontairement ou pas. En fait, on pouvait sans doute punir quelqu’un en le retirant de sa famille et de son cercle d’amis, en l’isolant dans un pays froid et en le détruisant à coups de solitude.
Troisièmement, et ceci était un fait et non une question : pourquoi notre amour avait-il si peu compté pour Ba ?
J’avais dû m’endormir, car je me suis éveillée en sursaut pour apercevoir Ma penchée sur moi. Elle m’essuyait le visage de ses doigts. Je ne pleurais jamais le jour, seulement la nuit.
– Ne te mets pas dans cet état, Li-ling.
Elle marmonnait toutes sortes de choses.
– Si tu es enfermée dans une pièce et que personne ne vient te sauver, que fais-tu ? Tu frappes sur les murs, tu casses les fenêtres. Tu dois grimper, sortir de là et te sauver. Il est évident que pleurer n’a jamais aidé qui que ce soit à vivre, Li-ling.
– Je m’appelle Marie, ai-je crié. Marie !
Elle a souri.
– Qui es-tu ?
– Je suis Li-ling !
– Tu es Fille.
C’était le surnom que me donnait mon père, parce que 女 englobait les deux sens du mot fille : « enfant de sexe féminin » et « descendante ». Il disait à la blague que, là d’où il venait, les pauvres ne se donnaient pas la peine de baptiser leurs filles. Ma lui frappait alors l’épaule et répliquait en cantonais : « Ne lui bourre pas le crâne de foutaises. »
Protégée par son étreinte, je me suis à nouveau coulée vers le sommeil.
Plus tard, j’ai été réveillée par Ma qui baragouinait des pensées sans queue ni tête. Elle gloussait. Ces matins d’hiver étaient vides de toute lumière, mais le rire inattendu de Ma a fendu la pièce comme le bourdonnement du radiateur électrique. Sa peau sentait les oreillers propres, l’osmanthus sucré de sa pommade.
J’ai chuchoté son nom, et elle a marmotté :
– Hé.
Puis :
– Hé hé.
– Est-ce que tu marches sur la terre ou sur la mer ? ai-je demandé.
– Il est là, a-t-elle répondu très distinctement.
– Qui ?
Je tentais de percer l’obscurité de la pièce. Je croyais vraiment qu’il était là.
– Homme adoptif. Ce hmmm. Ce… Professeur.
J’ai attrapé ses doigts. De l’autre côté du rideau, le ciel changeait de couleur. Je voulais la suivre dans le passé de mon père, mais je n’avais pas confiance. Les gens suivaient parfois des illusions ; ils pouvaient entrevoir quelque chose de si envoûtant qu’ils négligeaient de faire demi-tour. Je craignais que, comme mon père, elle oublie pourquoi elle devait revenir.
La vie extérieure – le début de la nouvelle année scolaire, la régularité des examens, les joies du camp mathématique – suivait son cours comme si elle était éternelle, propulsée par le monde circulaire des saisons. Les manteaux d’été et d’hiver de mon père attendaient toujours près de la porte, sous ses chapeaux, au-dessus de ses chaussures.
Au début du mois de décembre, une épaisse enveloppe nous est parvenue de Shanghai et Ma s’est une fois de plus installée avec son dictionnaire. Il s’agit d’un petit format extrêmement épais à couverture cartonnée verte et blanche. Les pages, quand je les tourne, sont diaphanes et ne pèsent rien. Ici et là, je trouve une tache de gras ou un cerne de café, la tasse de ma mère ou peut-être la mienne. Chaque mot est classé selon sa racine, également appelée radical. Par exemple, 門 signifie « portail », mais c’est aussi un radical, c’est-à-dire un élément de base pour construire d’autres mots et concepts. Si la lumière, ou le soleil 日 brille à travers le portail, on obtient l’espace 間. S’il y a un cheval 馬 dedans, c’est une embuscade 闖, et s’il y a une bouche 口 au centre du portail, on a une question 問. S’il y a un œil 目 et un chien 犬, on obtient le silence 闃.
La lettre de Shanghai faisait trente pages et était rédigée en pattes de mouche ; après quelques minutes, je me suis fatiguée de regarder ma mère s’échiner dessus. Je suis allée dans la pièce du devant et j’ai observé les voisins. De l’autre côté de la cour, j’ai vu un misérable arbre de Noël. On aurait dit que quelqu’un avait essayé de l’étrangler avec une guirlande.
La pluie fouettait et le vent sifflait. J’ai servi un verre de lait de poule à ma mère.
– C’est une belle lettre ?
Ma a déposé les feuilles. Ses paupières avaient l’air enflées.
– Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais.
J’ai passé le doigt sur l’enveloppe et commencé à décrypter le nom sur l’adresse de retour. Il m’a étonnée.
– Une femme ? ai-je demandé, subitement inquiète.
Ma mère a acquiescé.
– Elle nous demande quelque chose, a dit Ma en m’enlevant l’enveloppe pour la fourrer sous la paperasse.
Je me suis rapprochée d’elle, comme si elle était un vase sur le point de tomber de la table, mais ses yeux bouffis exprimaient une émotion inattendue. Le réconfort ? Ou peut-être, à ma grande surprise, la joie.
– Elle nous demande un service, a-t-elle poursuivi.
– Tu veux bien me lire la lettre ?
Elle s’est pincé l’arête du nez.
– C’est très long. Elle dit qu’elle n’a pas vu ton père depuis des années. Mais qu’à l’époque ils étaient comme une famille.
Elle avait hésité sur le mot famille.
– Elle dit que son mari était le professeur de composition de ton père, au conservatoire de musique de Shanghai. Mais ils s’étaient perdus de vue. Pendant les années difficiles.
– Quelles années difficiles ?
Je commençais à soupçonner que ce service impliquerait des dollars américains ou un nouveau réfrigérateur, et craignais qu’on profite de Ma.
– Avant ta naissance. Dans les années soixante. À l’époque où ton père était étudiant en musique.
Ma a baissé les yeux, insondable.
– Elle dit que ton père les a contactés l’an dernier. Ba lui a écrit de Hong Kong quelques jours avant de mourir.
Une foule de questions montaient en moi. Je savais qu’il ne fallait pas l’embêter, mais je voulais comprendre, aussi ai-je fini par dire :
– C’est qui ? Comment s’appelle-t-elle ?
– Son nom de famille est Deng.
– Mais son prénom ?
Ma a ouvert la bouche, mais aucun son n’en est sorti. Enfin, elle m’a regardée droit dans les yeux en me le révélant :
– Son prénom est Li-ling.
Elle avait le même nom que moi, sauf qu’il était écrit en chinois simplifié. J’ai tendu la main vers la lettre. Fermement, Ma a posé la sienne dessus. Anticipant ma question suivante, elle l’a devancée :
– Ces trente pages concernent le présent, pas le passé. La fille de Deng Li-ling est arrivée à Toronto, mais elle ne peut pas utiliser son passeport. Elle n’a nulle part où aller, elle a besoin de notre aide. Sa fille…
Prestement, Ma a glissé la lettre dans l’enveloppe.
– Sa fille va venir vivre avec nous pendant un certain temps. Tu comprends ? Cette lettre concerne le présent.
Je me sentais toute de travers, à l’envers. Pourquoi une étrangère viendrait-elle vivre avec nous ?
– Sa fille s’appelle Ai-ming, a dit Ma pour me ramener. Je vais lui téléphoner tout de suite et organiser son arrivée.
– Est-ce que nous sommes du même âge ?
Perplexe, Ma a répondu :
– Non, elle doit bien avoir dix-neuf ans, elle est étudiante. Deng Li-ling dit que sa fille… elle dit qu’Ai-ming a eu des ennuis à Pékin pendant les manifestations de la place Tian’anmen. Elle s’est enfuie.
– Quelle sorte d’ennuis ?
– Ça suffit, a tranché ma mère. Tu sais tout ce que tu as à savoir.
– Non ! J’ai besoin d’en savoir plus.
Exaspérée, Ma a refermé le dictionnaire d’un geste brusque.
– Qui t’a élevée ? Tu es trop jeune pour être aussi curieuse !
– Mais…
– Ça suffit.
Ma a attendu que je sois au lit pour faire son appel. Elle parlait dans sa langue maternelle, le cantonais, avec de brèves interjections en mandarin, et même à travers la porte close, je percevais ses hésitations sur les tons qui ne lui avaient jamais été naturels. Je l’entendais demander :
– Il fait très froid, là où tu es ?
Puis :
– Le billet de train t’attendra à…
J’ai retiré mes lunettes et examiné la fenêtre floue. La pluie ressemblait à de la neige. La voix de Ma me paraissait étrangère.
Après un long silence, j’ai raccroché mes lunettes à mes oreilles, quitté mon lit et ma chambre. Ma avait une pile de factures devant elle et un stylo à la main, comme si elle attendait une dictée.
– Où sont tes chaussons ? a-t-elle dit en me voyant.
Je lui ai répondu que je l’ignorais.
Elle a alors explosé :
– Va te coucher, Fille ! Pourquoi tu ne comprends pas ? Je veux juste la paix ! Tu ne me laisses jamais tranquille, tu me regardes toujours comme si tu pensais que j’allais…
Elle a plaqué le crayon sur la table. Un morceau s’en est détaché et a volé au plancher.
– Tu penses que je vais partir ? Tu crois que je suis aussi égoïste que lui ? Que je pourrais t’abandonner, te faire souffrir comme il l’a fait ?
Il y a eu une longue et violente explosion en cantonais, puis :
– Va donc te coucher !
Elle paraissait si vieillie, si fragile, assise là avec son vieux dictionnaire trop lourd.
J’ai filé aux toilettes, claqué la porte, avant de la rouvrir pour la claquer encore plus fort, puis j’ai fondu en larmes. J’ai commencé à me faire couler un bain tout en réalisant qu’en fait je voulais vraiment aller au lit. Mes sanglots se sont transformés en hoquets et, quand les hoquets se sont enfin arrêtés, je n’ai entendu rien d’autre que l’eau qui jaillissait. Juchée sur le bord de la baignoire, j’observais mes pieds se distordre sous la surface. Je me suis immergée, mes jambes pâles se sont repliées.
Ba est revenu dans ma mémoire. Il enfonçait une cassette dans le lecteur de la voiture, me demandait de baisser les vitres, et nous planions dans Main Street, suivions le Great Northern Way en faisant tonner le concerto « Empereur » de Beethoven, interprété par Glenn Gould et dirigé par Leopold Stokowski. Les notes culbutaient, cascadaient vers le bas puis vers le haut, à l’infini, et mon père jouait les chefs d’orchestre avec sa main droite tout en conduisant de la gauche. J’entendais son fredonnement mélodique et percutant, DA ! DA-di-di-di DA !
Da, da, da ! J’avais la sensation, pendant que nous paradions triomphalement à travers Vancouver, que le premier mouvement était créé non pas par Beethoven, mais par mon père. Sa main décrivait la forme de la mesure 4/4, l’excitation du suspense entre le quatrième temps et le premier, et je me demandais ce que cela signifiait qu’un homme qui avait été célèbre, qui avait joué à Pékin pour nul autre que Mao Zedong, n’ait même pas de piano chez lui. Qu’il gagne sa vie en travaillant dans une boutique. En fait, malgré mes supplications, mon père avait toujours refusé que je suive des cours de violon. Pourtant, nous parcourions la ville dans l’étreinte de cette musique victorieuse, de sorte que le passé, celui de Beethoven et celui de mon père, ne mourait jamais ; il retentissait sous le pare-brise puis s’élevait pour nous envelopper, comme le soleil.
La Buick n’existait plus ; Ma l’avait vendue. Ma mère avait toujours été la plus coriace, comme le cactus du salon, seule plante ayant survécu au départ de Ba. Pour vivre, mon père avait besoin de plus. L’eau du bain coulait toujours sur moi. Honteuse de ce gaspillage, j’ai fermé le robinet d’une main ferme. Mon père m’avait un jour dit que la musique était pleine de silences. Il ne m’avait rien laissé, ni lettre ni message. Pas un mot.
Ma a frappé à la porte.
– Marie.
Elle a tourné la poignée, mais c’était verrouillé.
– Tout va bien, Li-ling ?
Un long moment a passé.
La vérité était que j’aimais plus mon père que ma mère. Ce constat m’est venu en même temps que la certitude qu’il souffrait énormément, et que jamais ma mère ne m’abandonnerait, jamais. Elle l’avait aimé, elle aussi. En pleurant, j’ai posé les mains sur la surface de l’eau.
– Je voulais juste prendre un bain.
– Oh, a-t-elle dit.
Sa voix semblait résonner à l’intérieur de la baignoire.
– N’attrape pas froid.
Elle a de nouveau tenté d’ouvrir la porte, mais elle était toujours verrouillée.
– On va s’en tirer, a-t-elle fini par dire.
Plus que tout au monde, je voulais nous sortir de ce rêve. Au lieu de cela, j’ai rincé mes larmes, impuissante, et j’ai acquiescé.
– Je sais.
J’ai écouté s’estomper le son de ses chaussons qui s’éloignaient.
Le 16 décembre 1990, Ma est rentrée en taxi avec sa nouvelle fille, qui ne portait pas de manteau, seulement une écharpe épaisse, un pull en laine, un jean et des chaussures de toile. Je n’avais jamais rencontré une Chinoise, c’est-à-dire une fille qui, comme mon père, venait de la véritable Chine continentale. Pendues à son cou par un cordon, des mitaines grises se balançaient contre ses jambes à un rythme nerveux. Les bouts frangés de son écharpe bleue tombaient l’un devant, l’autre derrière, comme celles des universitaires. Il pleuvait dru et elle marchait tête baissée en portant une valise de taille moyenne qui avait l’air vide. Elle était pâle, et ses cheveux lançaient des reflets comme la mer.
J’ai ouvert la porte avec nonchalance et écarquillé les yeux, comme si je ne m’attendais pas à recevoir des visiteurs.
– Fille, a dit Ma, prends sa valise. Dépêche-toi.
Ai-ming est entrée et elle s’est arrêtée au bord du paillasson. Quand j’ai voulu prendre sa valise, ma main a involontairement effleuré la sienne, mais elle n’a eu aucun mouvement de recul, tendant plutôt son autre main pour en couvrir la mienne, tout doucement. Elle me regardait avec tant de franchise et de curiosité que, par timidité, j’ai fermé les yeux.
– Ai-ming, disait Ma, permets-moi de te présenter ma Fille.
J’ai retiré ma main et rouvert les yeux.
Ma a enlevé son manteau et jeté un œil sur moi, puis sur la pièce. Le canapé marron, avec ses trois rayures brun clair, avait connu des jours meilleurs, mais je l’avais rajeuni avec tous les coussins fleuris et les peluches que j’avais sur mon lit. J’avais aussi allumé la télévision pour donner à la pièce un air animé. Ma m’a adressé un vigoureux signe de tête.
– Fille, dis bonjour à ta tante.
– En fait, tu peux m’appeler Ai-ming. S’il te plaît. Vraiment, je, euh, je préfère.
– Hello, ai-je déclaré pour leur clouer le bec.
Comme je le soupçonnais, la valise était très légère. J’ai tendu ma main libre pour prendre le manteau d’Ai-ming, me rappelant trop tard qu’elle n’en avait pas. Mon bras oscillait en l’air comme un point d’interrogation. Elle a attrapé ma main et l’a serrée fermement.
Il y avait une question dans ses yeux. Ses cheveux, relevés d’un côté, tombaient librement de l’autre, de sorte qu’elle semblait toujours être de profil, sur le point de se tourner vers moi. Sans lâcher ma main, elle est parvenue à enlever ses chaussures, d’abord l’une, puis l’autre, sans bruit. Des pointes de pluie scintillaient sur son écharpe. Nos vies s’étaient tellement contractées que je ne me souvenais plus de la dernière fois qu’un étranger était entré chez nous ; la présence d’Ai-ming rendait tout étrange, comme si les murs s’étaient rapprochés de quelques centimètres pour mieux la voir. La veille au soir, nous avions enfin rangé les papiers et les carnets de Ba dans des boîtes que nous avions empilées sous la table. Et maintenant, sa surface me paraissait faussement nue. J’ai dégagé ma main et annoncé que j’allais mettre la valise dans sa chambre.
Ma lui a fait faire le tour de l’appartement. Je me suis repliée sur le canapé et j’ai fait mine de regarder la chaîne météo qui annonçait de la pluie pendant le reste de la semaine, le reste de l’année, le reste du siècle et jusqu’à la fin des temps. Leurs deux voix passaient l’une après l’autre comme des tramways, interrompues ici et là par le silence. L’intensité qui régnait dans l’appartement s’insinuait en moi, et j’avais l’impression que le sol était fait en papier, que partout des mots étaient écrits que je ne pouvais lire, et qu’un geste irréfléchi aurait suffi à faire s’affaisser l’endroit au complet.
Nous avons mangé ensemble à la table. Ma avait enlevé la rallonge, transformant en cercle l’œuf qu’avait été sa surface. Elle a interrompu son radotage pour me décocher un regard qui voulait dire : Arrête de la dévisager.
De temps à autre, mon pied heurtait accidentellement une des boîtes sous la table, ce qui faisait sursauter Ai-ming.
– Ai-ming, es-tu incommodée par le froid ? s’est enquise plaisamment Ma tout en m’ignorant. Pour ma part, je n’avais jamais connu l’hiver avant de venir au Canada.
– Il y a des hivers à Pékin, mais ça ne me déplaisait pas. En fait, j’ai grandi loin de là, dans le Sud, où il fait chaud et humide, alors quand nous avons déménagé à Pékin, le froid était pour moi une nouveauté.
– Je ne suis jamais allée dans la capitale, mais j’ai entendu dire que le vent y charrie la poussière des déserts de l’Ouest.
– C’est vrai, a confirmé Ai-ming en souriant. La poussière se glissait dans nos vêtements, nos cheveux et même notre nourriture.
Assise face à elle, je constatais qu’elle avait bel et bien dix-neuf ans. Ses yeux étaient bouffis et fatigués, et curieusement, ils me rappelaient le visage endeuillé de Ma. Parfois, je pense qu’il suffit d’un regard pour savoir qu’une personne est remplie de mots. Ces mots peuvent être retenus par la douleur ou la pudeur, ou encore par subterfuge. Peut-être que ce sont des mots en lame de couteau, qu’ils attendent de faire couler le sang. Je me sentais à la fois enfant et adulte. Je voulais qu’on nous laisse tranquilles, Ma et moi, mais, pour une raison inexplicable, je voulais aussi être proche d’elle.
– Quel est le ming dans Ai-ming ? ai-je demandé en anglais, en assénant un coup de pied à une boîte pour plus d’effet. Est-ce que c’est le ming qui veut dire « comprendre », ou celui qui veut dire « destin » ?
Elles m’ont dévisagée.
– Mange ton poulet, m’a ordonné Ma.
La fille m’examinait d’un air réjoui. Elle a tracé une forme dans les airs entre nous, 明. Le soleil et la lune mis ensemble pour créer la compréhension, ou la clarté. C’était un mot de tous les jours.
– Mes parents voulaient rendre le concept de aì míng. « Chérir la sagesse ». Mais tu as raison, il y a une ambiguïté là-dedans. L’idée de… hmmm, pas chérir le destin, pas exactement, mais l’accepter.
Reprenant son bol, elle a enfoncé le bout de ses baguettes dans la masse tendre du riz.
Ma lui a demandé si elle avait besoin de quelque chose, ou s’il y avait quelque chose qu’elle souhaitait faire.
Ai-ming a reposé son bol.
– Honnêtement, j’ai l’impression de ne pas avoir eu une bonne nuit de sommeil depuis longtemps. À Toronto, je n’arrivais pas à me reposer. Je devais déménager toutes les deux ou trois semaines.
– Déménager ? a demandé Ma.
Ai-ming a frémi.
– Je pensais… J’avais peur de la police. Je craignais qu’ils me renvoient. Je ne sais pas si ma mère a pu tout vous raconter. Je l’espère...
Extraits

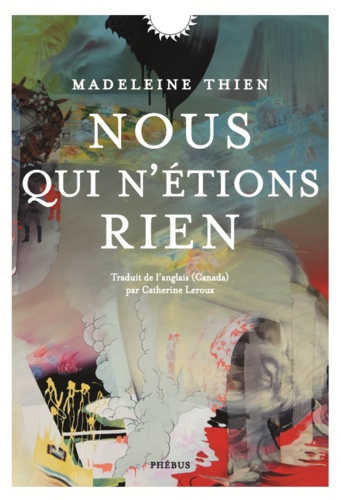


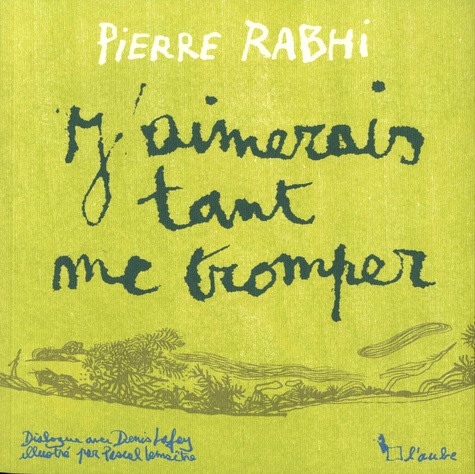
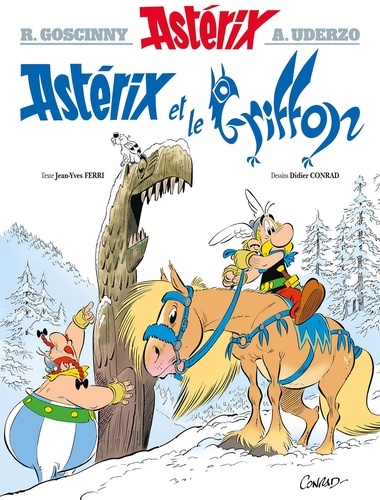
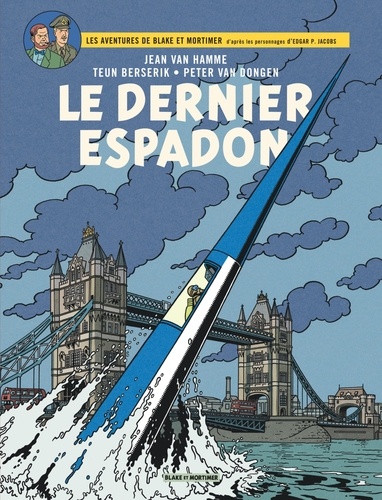
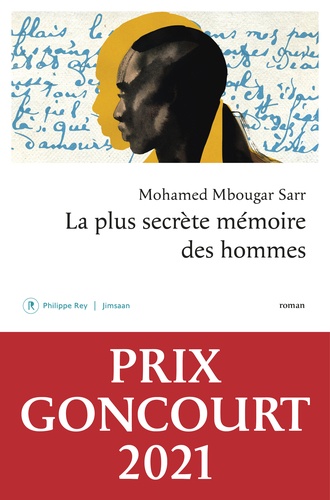
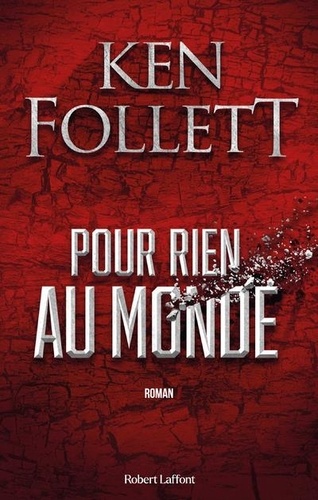
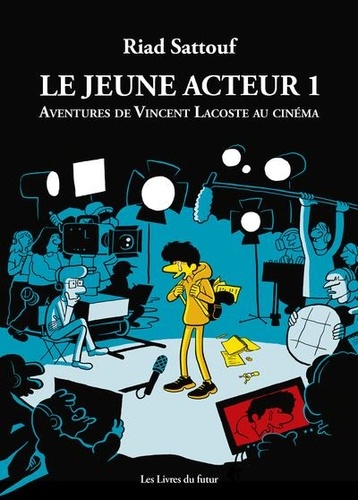
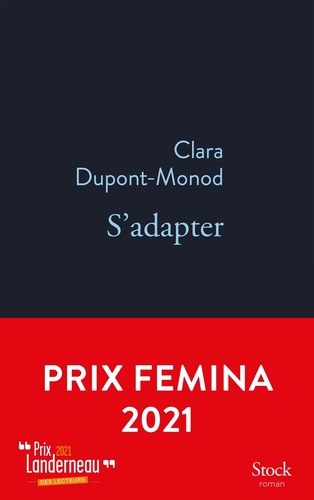
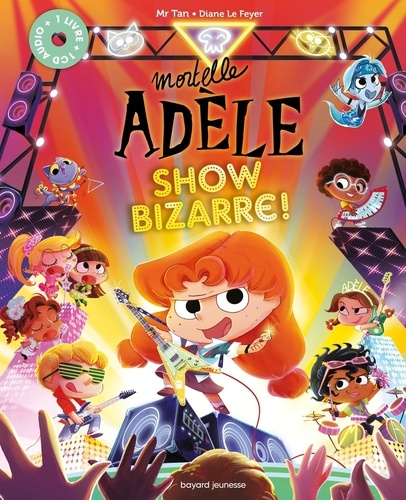
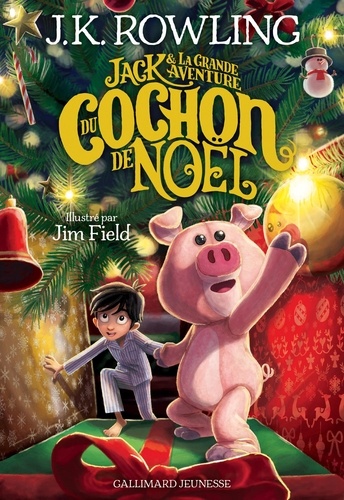


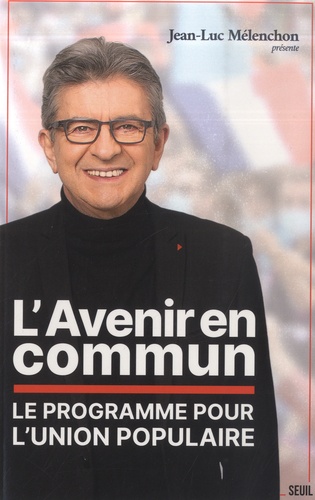

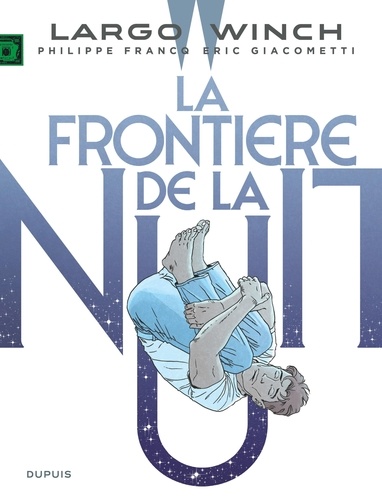

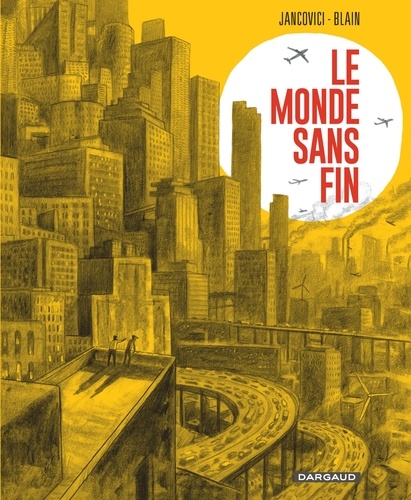
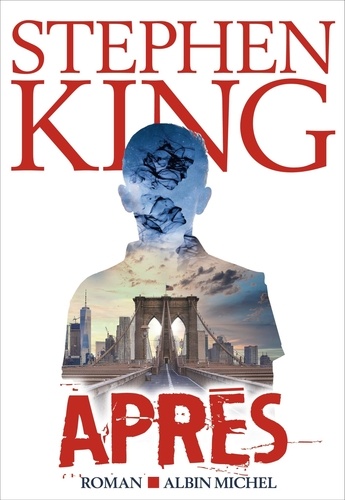

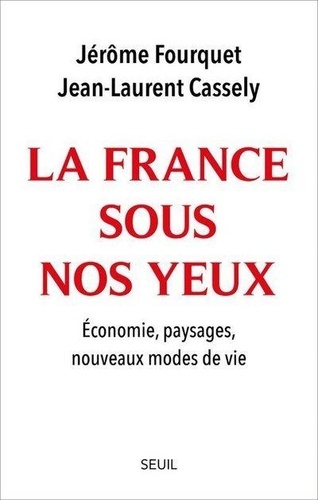
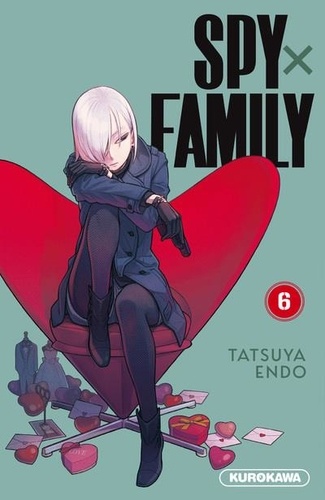
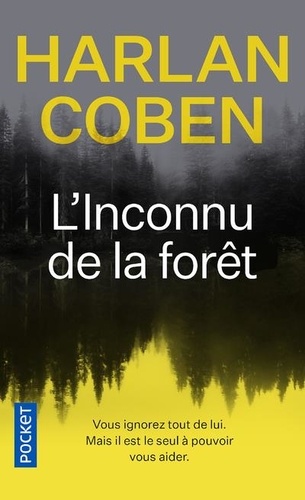


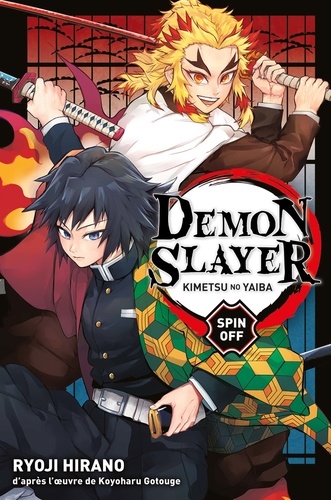
Commenter ce livre