AU FOND
Philippe Artières
À mes sœurs Hélène et Cécile
Bien entendu, un historien, même s’il est un amateur, a toujours des documents. Le narrateur de cette histoire a donc les siens : son témoignage d’abord, celui des autres ensuite, puisque, par son rôle, il fut amené à recueillir les confidences de tous les personnages de cette chronique, et, en dernier lieu, les textes qui finirent par tomber entre ses mains. Il se propose d’y puiser quand il le jugera bon et de les utiliser comme il lui plaira. Il se propose encore...
Albert CAMUS, La Peste, 1947
Paris, automne 2013
Je sors de chez elle, ma seconde séance de la semaine ; je viens de lui serrer la main puis de lui remettre un billet froissé de cinquante euros ; elle me dit : « À mardi prochain. » Je n’ai pas envie de rentrer chez moi, j’ai besoin d’errer.
Je marche dans la ville. Rue Quincampoix, j’entre dans une galerie de photographie. L’espace est désert. Dans la deuxième pièce, je me retrouve soudain témoin d’une scène troublante. Ils sont deux, l’un derrière l’autre, debout, de dos, ils ont peut-être vingt ans ; on ne voit pas leurs visages, seulement leurs cheveux taillés pareillement ; leurs corps se ressemblent ; ils portent des vêtements identiques : une chemise de coton sous une paire de bretelles – sont-ils des frères jumeaux ? Dans cette forêt, les deux garçons paraissent hors du temps ; ils fixent tous les deux un point au loin ; dans la main de l’un d’entre eux pend une tronçonneuse rouge. Au second plan, un bel arbre, un chêne ; il est à terre ; ils viennent de l’abattre, il n’a plus de feuilles, comme tous les arbres environnants. C’est l’hiver. Au fond de l’image, on distingue de l’eau : un cours d’eau vaseux, un trou boueux ou bien une source. Nul ne saura jamais s’ils iront jusque-là ou resteront sur ce promontoire où ils se tiennent.
Je vais voir le galeriste et lui demande le prix de la photographie ; je sors mon chéquier et sans réfléchir lui fais un chèque de cinq mille euros. Il m’explique que je ne peux pas avoir l’œuvre maintenant mais qu’à la fin de l’exposition, je peux passer la chercher.
Pourquoi cette scène saisie par ce photographe m’a-t-elle troublé au point de vouloir la posséder ? Je ne connais pas ce bois, je n’ai pas foulé cette boue, je n’ai pas parlé à ces hommes ; on ne m’aperçoit pas sur l’image mais je suis là caché derrière un arbre. On ne voit pas l’enfant mais il est là à côté du photographe, on ne distingue pas le cadavre des morts et pourtant, ils demeurent là-bas dans cette terre remuée.
Et puis il y a cette autre photographie avec ces deux femmes ; elle est juste en face dans l’accrochage ; je les reconnais. Je les ai croisées à Cirey quand j’étais enfant. Le son de leurs voix se fait de plus en plus fort. Je ne comprends pas ce qu’elles disent, non qu’elles parlent une langue étrangère, mais parce qu’elles déparlent. Leurs voix me deviennent insupportables.
Extraits

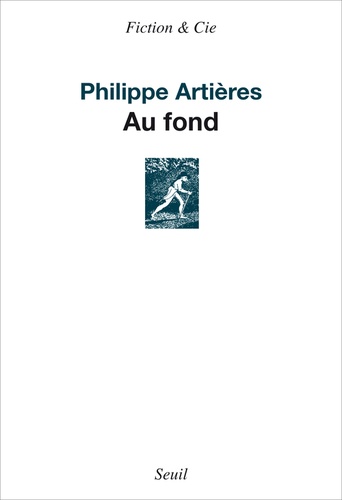


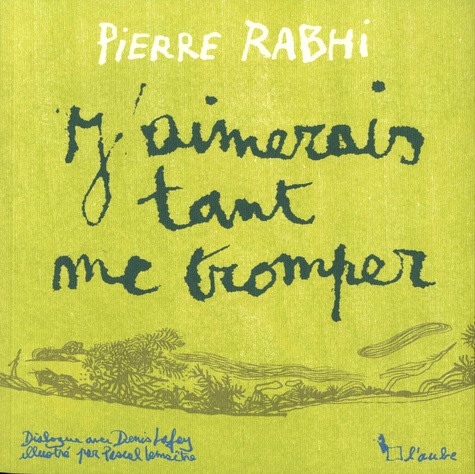
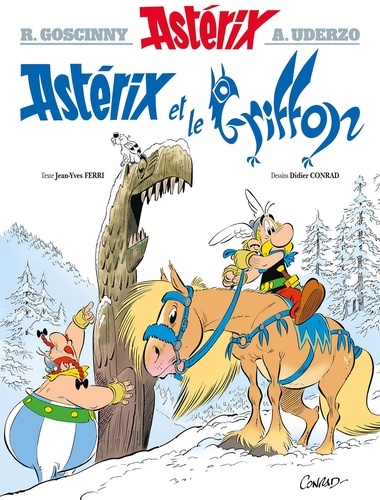
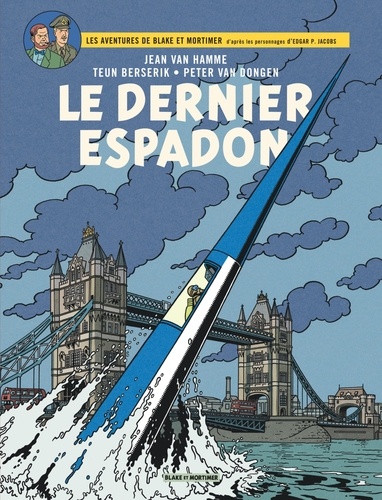
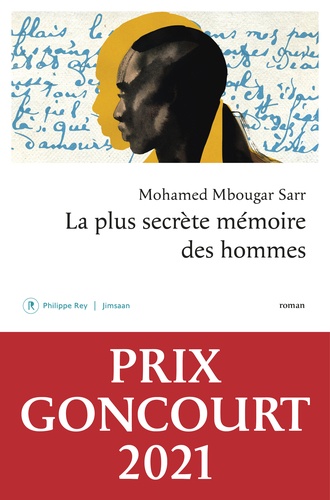
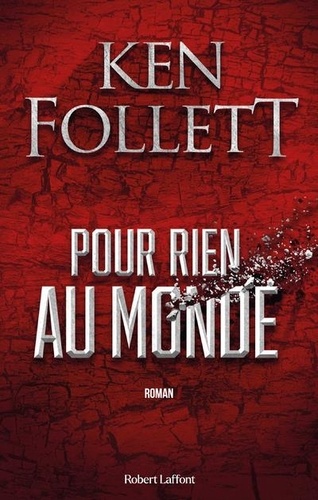
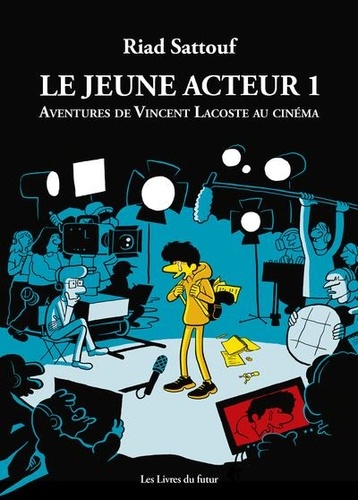
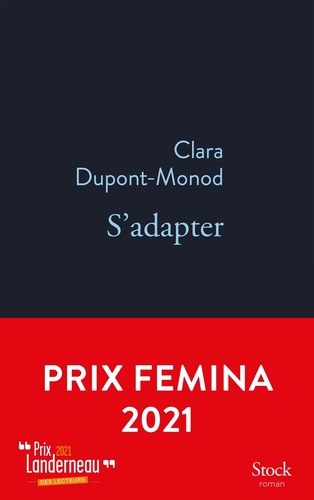
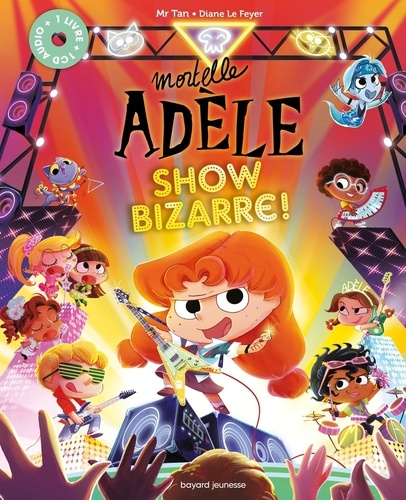
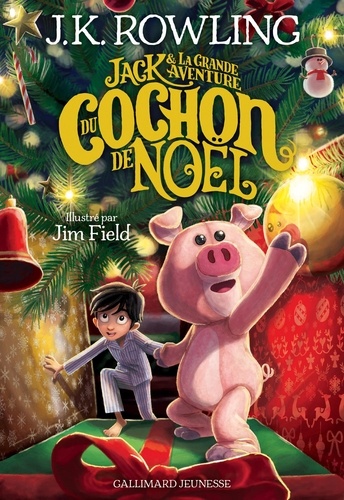


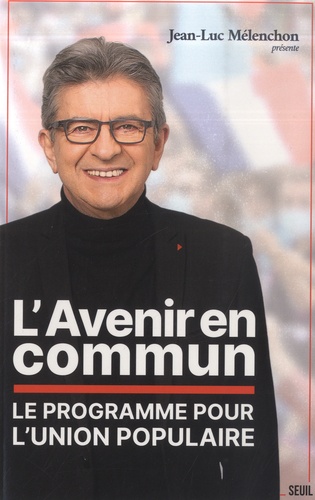

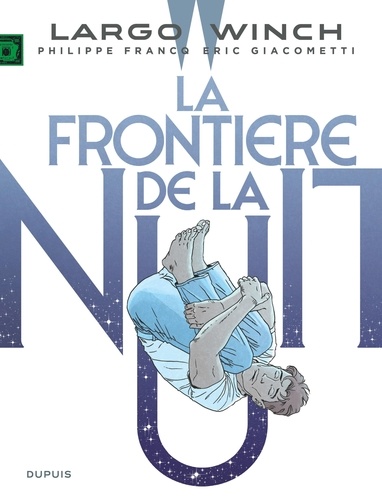

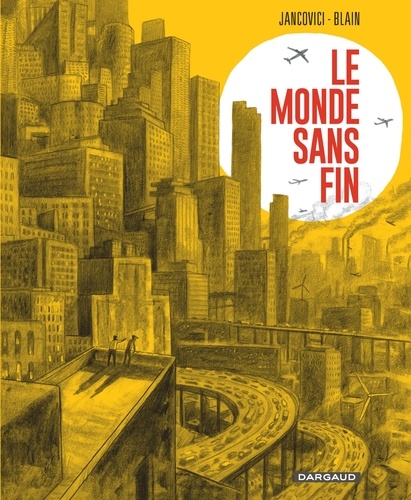
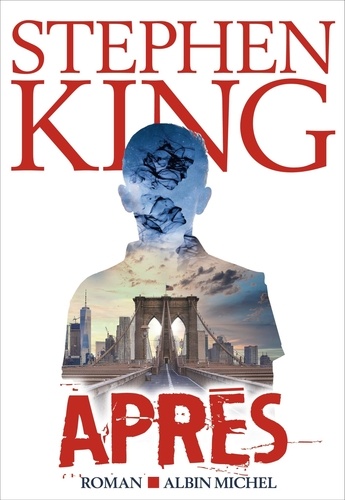

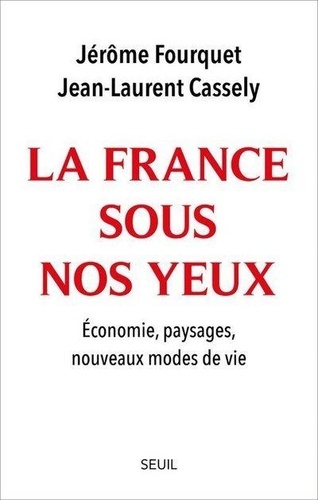
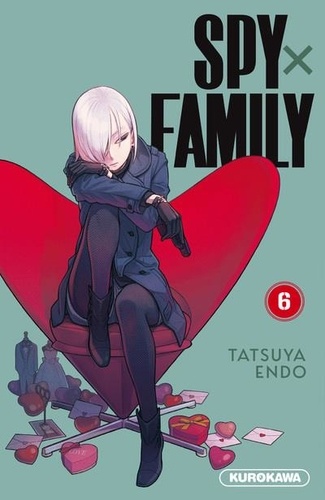
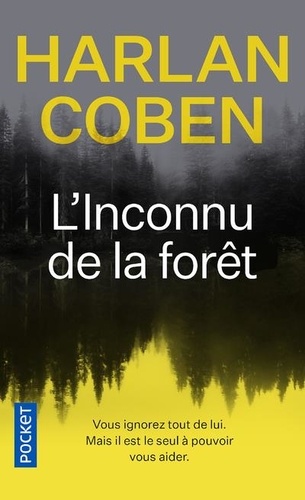


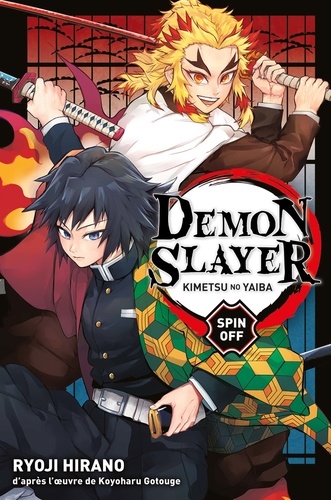


Commenter ce livre